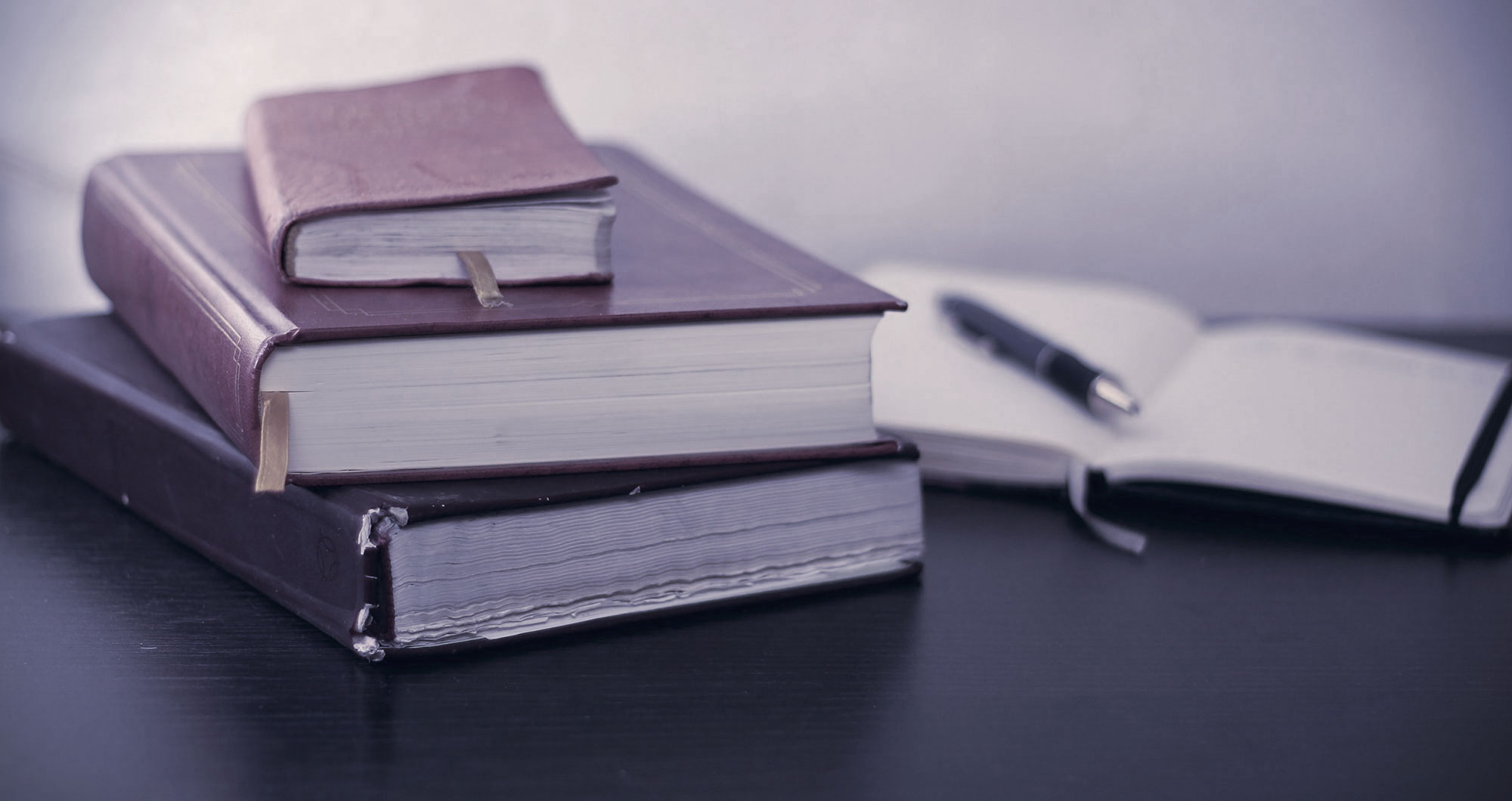
Instruction en famille : rappels législatifs et apports récents de la jurisprudence
L’instruction en famille (IEF) est encadrée de manière stricte par la loi française depuis la réforme opérée par la loi du 24 août 2021. Désormais, l'autorisation préalable est obligatoire pour tout parent souhaitant instruire son enfant à domicile. Ce régime dérogatoire est restreint à des motifs précis, dans un souci de conciliation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et l’exigence de contrôle de l'État.
Une procédure d’autorisation fondée sur des critères stricts
Les parents doivent déposer leur demande avant le 31 mai précédant l’année scolaire concernée. Cette demande ne peut être acceptée que pour les motifs limitativement énumérés par la loi, notamment :
- L’état de santé ou le handicap de l’enfant,
- La pratique intensive d’une activité artistique ou sportive,
- L’itinérance ou l’éloignement géographique de la famille,
- L’existence d’une situation propre à l’enfant justifiant le projet éducatif.
Il appartient aux familles de démontrer que leur situation entre dans l’un de ces cadres. Cette rigueur conduit de nombreuses demandes à être rejetées, ce qui alimente un contentieux administratif croissant.
Jurisprudence récente : enseignements du tribunal administratif de Rennes
Le tribunal administratif de Rennes a récemment rendu plusieurs décisions concernant l’IEF. Il ressort de cette jurisprudence que le taux d’annulation des décisions de refus est faible. Cela s’explique en partie par le fait que certaines autorisations sont délivrées au cours de la procédure, notamment à l’issue du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Ces décisions illustrent aussi que le motif lié à la "situation propre à l’enfant" est au cœur du contentieux. Ce critère, plus subjectif, donne lieu à des appréciations diverses de la part de l’administration, ouvrant potentiellement la voie à une contestation juridiquement fondée.
Dès lors, l’accompagnement par un avocat est essentiel. Il permet une analyse précise des chances de succès, tant au stade du RAPO que devant le tribunal administratif.
Les recours contre une décision de refus
La contestation d’un refus d’autorisation d’IEF suit une procédure en deux étapes :
- RAPO dans les 15 jours suivant la notification du refus, adressé à une commission présidée par le recteur d’académie. Ce recours est obligatoire : sans lui, tout recours contentieux sera déclaré irrecevable.
- En cas de rejet du RAPO, saisine du tribunal administratif dans un délai de 2 mois pour demander l’annulation de la décision de refus.
Il est également possible, dans les cas urgents, de former un référé-suspension, permettant de demander la suspension de la décision de refus en attendant que le tribunal statue.
La multiplication de contentieux sur ce sujet montre que, bien que l’IEF soit une liberté encadrée, elle reste juridiquement défendable lorsque les conditions légales sont remplies. La vigilance sur les délais et la qualité du dossier sont essentielles pour obtenir gain de cause.
